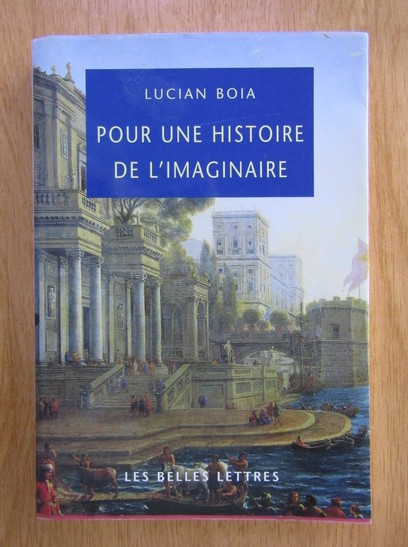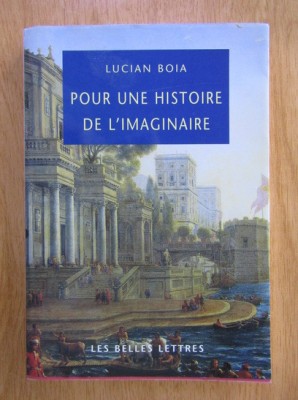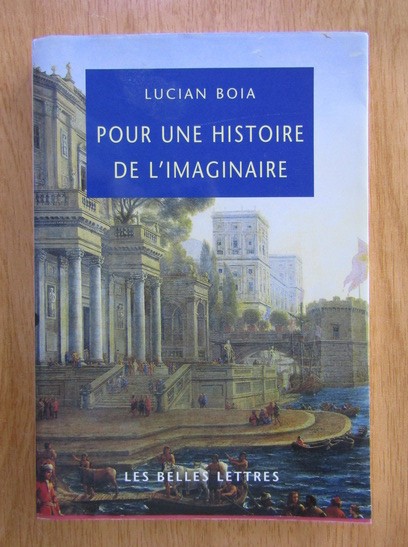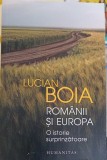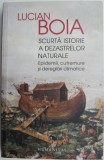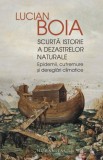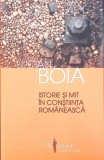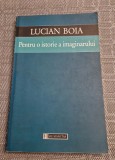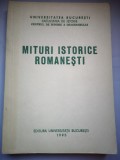Dans une première partie, l’auteur met en place une méthodologie : il cherche à définir l’imaginaire et présente son projet de faire son histoire. Cette partie est particulièrement intéressante. Boia propose une définition de l’imaginaire plutôt large, récusant Sartre, l’inventeur de la notion, qui considère que la conscience de l’image contient une "pauvreté essentielle" (il n’y a rien de plus dans la conscience de l’image que ce dont on a précédemment eu connaissance par la perception). Boia oriente sa définition du côté de l’histoire et expose le débat sur l’imaginaire entre les savants de divers horizons qui se sont intéressés à cette notion, en particulier l’historien Jacques Le Goff et l’anthropologue Gilbert Durand. Il fait en effet la synthèse entre une vision historienne et une vision anthropologique et anhistorique de l’imaginaire : il reprend à Durand qui définit l’imaginaire comme la "négation éthique du négatif l’idée des archétypes, mais il lui ajoute la notion de modèle : il découvre dans l’imaginaire un fond archétypal constant mais en historien il nous montre l’évolution et l’émergence des modèles. A partir d’une liste de huit archétypes, l’auteur va montrer les modalités de l’imaginaire à travers les thèmes de la science, de la religion, de la politique, des idéologies...
Il met à l’épreuve cette méthodologie dans le second chapitre consacré à l’imaginaire scientifique : il montre de manière convaincante comment le rationalisme et la technologie dérivent des mêmes archétypes que dans des civilisations qui ne se basent pas sur la Raison et la science. Le "catéchisme positiviste" de Comte ne fait que laïciser de vieilles figu¬ res imaginaires et la vulgarisation pseudo-scientifique fonctionne tou¬ jours sur les mêmes fantasmes.
Les chapitres suivants reprennent le même principe. L’auteur développe les archétypes qu’il a proposés au début, en particulier ceux de "l’altérité" et de "l’évasion" montrant dans de nombreux exemples quelles implications ceux-ci peuvent avoir en politique, dans les repré¬ sentations historiques et géographiques, ou à un niveau plus familier.
Les deux axes de la politique et de l’histoires sont également lus à partir de cette grille des archétypes : Boia montre que les mêmes mécanismes de l’imaginaire, différemment combinés, se retrouvent dans bien des idéologies. Son analyse de l’imaginaire dans le communisme est très intéressante : il montre comment Marx est à la fois un pur produit de son époque et comment ses théories sont en même temps très tributaires d’archétypes constants, et comment ses successeurs ont eux-mêmes poursuivi dans sa voie en exacerbant les fantasmes inhérents au marxisme.
Cet ouvrage est particulièrement stimulant. L’approche de l’auteur, dans sa synthèse entre archétype et modèle, est originale et féconde. Les exemples donnés sont très nombreux et variés. En effet, comme le titre l’indique, l’auteur veut prouver la pertinence de sa théorie et montrer la validité de son entreprise, et cette volonté de convaincre fait qu’il multiplie à l’excès les exemples dans un grand nombre de domaines pour mettre en évidence la présence de l’imaginaire et son fonctionnement. Il arrive ainsi parfois qu’on ait l’impression d’une trop grande rapidité. De plus l’imaginaire finit par apparaître tellement universel qu’on ne voit plus toujours sa spécificité et qu’il semble être une sorte de tournure d’esprit commune. La définition large qui en est faite permet que de nombreux domaines soient abordés mais se révèle parfois trop large. D’autre part, les archétypes donnés au début sont certes tout à fait opératoires mais l’auteur ne justifie pas leur choix, ce qui est dommage.